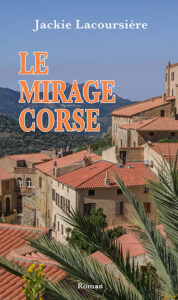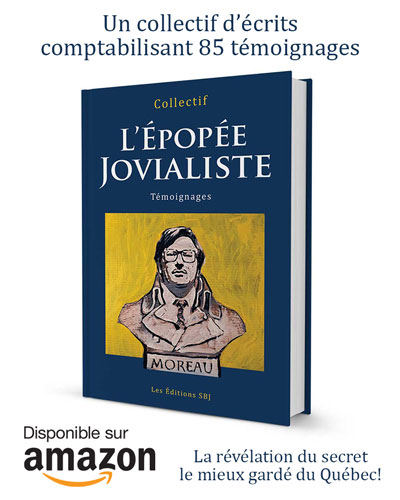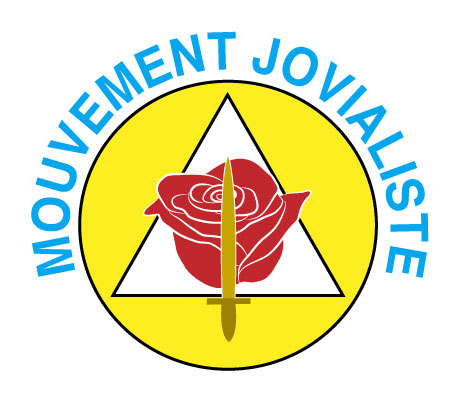Avais-je rêvé? Sans doute. Mais comme il était bon de conserver cette impression !
Le lendemain matin, comme à l’habitude, je fis la grasse matinée. Je pris le temps d’écrire les deux derniers rêves dont je me souvenais car, depuis quelques mois, je m’en faisais une règle.Dans le premier rêve, une dizaine d’adolescents me pourchassaient pour me faire du mal. Effrayée, je me mettais à courir afin d’échapper à leur emprise. Puis, épuisée et essoufflée, je tentais de m’évader en volant très haut dans les airs, comme il m’arrive parfois de le faire dans certains rêves. Après quelques essais infructueux, j’y parvins enfin. Je volais! De cette hauteur, je voyais tout. Je parcourus alors cinq ou six rues du quartier de mon enfance pour aboutir à une intersection. Soudain, une scène extraordinaire m’apparut : devant moi s’étalaient, sur une longueur et une largeur infinies, une multitude de banquises, telles qu’on doit en voir dans les régions reculées du Grand Nord! Sur certaines circulaient des ours polaires, tandis qu’un peu plus loin, des phoques plongeaient dans l’eau glacée. Un rêve étonnant! Des airs, je contemplais ce tableau majestueux se déployer devant mes yeux pendant que la fraîcheur de l’air froid emplissait mes poumons. La blancheur immaculée de la neige contrastant avec le bleu du ciel et les masses d’eau profondes, pleines de vie, les animaux marins, de même que le froid sur ma peau me semblaient si réels que j’aurais pu jurer, au matin, avoir vécu cette expérience.
Mon deuxième rêve n’était pas moins émouvant. Lors d’un festival quelconque, je marchais nonchalamment au milieu d’une foule nombreuse, lorsque je perçus progressivement une agitation fébrile autour de moi. Certaines personnes, dont le regard hystérique n’augurait rien de bon, empoignaient solidement les mains de leurs jeunes enfants et se dispersaient en toute hâte, ici et là, comme pour échapper à un danger imminent. À peine retournée, autant par crainte que par curiosité, et pour découvrir la raison de ce tumulte, je vis s’avancer, directement sur moi, un énorme éléphant paré de deux gigantesques défenses. Les rares personnes qui se tenaient encore auprès de moi, foudroyées de peur, couraient où ils le pouvaient afin d’éviter d’être piétinées par l’animal. Lorsque ce dernier arriva à ma hauteur, j’éprouvai une crainte terrifiante, jusqu’au moment où, à ma grande surprise, je sentis la tête de l’animal frôler docilement ma chevelure : de caresses en caresses, il me démontrait son affection et son attachement. Ses grands yeux noirs semblaient me dire qu’il était là pour me protéger.
Dès que j’eus terminé d’écrire ces deux rêves, je réalisai, une fois encore, à quel point ma vie onirique, quels qu’en puissent être les déploiements, pouvait constituer une riche source d’informations. Sous forme de petits scénarios, mes rêves me démontraient, en termes imagés, l’ampleur océanique du Soi profond : aucune menace, si apparente fût-elle, ne pouvait me contrarier.
Lors de ses multiples conférences, Moreau avait beaucoup insisté sur l’importance des rêves. Il suggérait même de se lever la nuit pour les noter, de façon à en devenir davantage conscient. « Cela nous procure, disait-il, une occasion d’aller puiser en nous des connaissances étonnantes. Un cauchemar, par exemple, représente très souvent le refus de ce que l’on ne peut ou ne veut admettre lorsque nous sommes éveillés. La peur d’affronter une personne ou un événement se transpose la nuit sous la forme d’un chat sale qui nous saute dessus, de serpents venimeux menaçants ou encore d’un homme sombre lancé à nos trousses. Le simple fait de nous rappeler du rêve et de prendre conscience de ses symboles peut nous aider à mettre en lumière quelque pensée obscure et ainsi, à mieux la cerner. Certains rêves peuvent même s’avérer prémonitoires et nous familiariser avec l’éventualité d’événements susceptibles de soulever notre appréhension ou notre intérêt. »
Un de ces rêves m’avait un jour sauvée d’un accident et, depuis, j’avais pris l’habitude de toujours les noter. Roulant très vite, ma voiture s’était retrouvée subitement dans le fossé au moment où l’asphalte cédait la place au gravier. Le lendemain, je rendais visite à une connaissance et filais à vive allure sur une petite route de campagne lorsque le rêve me revint en mémoire. Constatant que je dépassais largement la vitesse permise, je freinai progressivement. Trente mètres plus loin, l’asphalte devenait du gravier et le bord de la route donnait sur un fossé très profond. Or, c’était l’image exacte de mon rêve! Je sus immédiatement que celui-ci venait de m’éviter un accident. Le philosophe enseignait encore que d’autres rêves nous permettent d’expérimenter une situation en pensée de façon à mieux nous en tirer quand celle-ci se présente dans le réel. C’est comme une sorte de pratique avant l’examen. Certains encore, nous dévoilent l’identité véritable des gens (l’essence sous le masque) de façon à mieux les saisir. « Les rêves, en général, concluait-il, nous aident à faire la vidange des petites contrariétés de la vie et nous permettent, dans le cas des rêves érotiques, de concrétiser certains fantasmes ou de suppléer au manque de sexe ou d’affection. »
Après avoir rédigé mes rêves, je pris une douche et descendis chez Ève par les escaliers de service à l’étage inférieur.
Chaque matin, je m’y rendais pour préparer du café et chercher le journal que la « Déesse » avait laissé sur le comptoir de la cuisine après avoir fait ses mots croisés.
Je me dirigeais ensuite vers l’ascenseur pour me rendre à l’appartement de Moreau, trois étages plus haut. Son second appartement, devrais-je plutôt préciser, car, en plus d’habiter le même qu’Ève, il avait pris, une douzaine d’année plus tôt, un petit studio qui lui servait, comme il aimait à le dire, de boudoir, de « dormitoir », de salon de repos et de « baisodrome ». C’est à cet endroit, intime, chaleureux et chargé d’intensité qu’il recevait ses compagnes et les autres femmes.
En entrant, sur la gauche, il y avait sa salle de bains. Sur le mur d’en face, en oblique, était encastrée une cuisinette qui s’avérait bien inutile puisqu’il mangeait toujours chez Ève. Une bouilloire et quelques tasses qui traînaient sur le comptoir lui permettaient de se faire une tisane à l’occasion. Juste à côté de la cuisine, un meuble à tiroirs supportait une télévision au-dessus de laquelle était accrochée une grande photo de Berkeley, un philosophe du XVIIIe siècle auquel il avait consacré sa thèse de doctorat. Encore plus haut, presque à la limite du plafond, sur un carton blanc rectangulaire, il avait écrit avec un gros feutre noir le mot « Être ». C’est cela qui avait frappé mon attention la première fois que j’étais entrée dans cet appartement.
Au fond de la pièce, sur la gauche, un immense miroir mural donnait l’impression de doubler la longueur du lit. En face, dans une alcôve, petit coin où le philosophe aimait écrire, il y avait une table ovale et deux chaises droites. Sur la table, une lampe se perdait parmi une multitude de papiers en désordre où il se retrouvait parfaitement. Y figuraient des photos de femmes, récemment rencontrées pour la plupart, des coupures de journaux portant sur des thèmes offerts à sa réflexion, son agenda, les coordonnées des gens intéressés à ses conférences qu’il classait dans un fichier selon les régions du Québec. Et bien sûr, sa plume fontaine, de l’encre et du papier ligné en abondance. De le voir se lever, la nuit, à cinq ou six reprises parfois, pour noter ses rêves, était toujours un moment magique pour moi : sous mes yeux, dans la pénombre, un grand homme décrivait ses expériences avec l’Invisible!
Une bibliothèque, recouvrant le fond de l’alcôve et le mur donnant sur l’extérieur de l’édifice, contenait biographies, romans et recueils de poésie. Tout près, sur une étagère appuyée à la fenêtre, les portraits de ses compagnes, agrandis en huit par onze, s’alignaient par ordre chronologique selon le moment de leur rencontre. Entre son lit et un classeur plein d’archives, sur lequel étaient déposés les portraits de ses parents décédés, ainsi que leurs cendres contenues dans une petite urne, il y avait un appareil de musculation. Tous les jours, Moreau faisait ses exercices de façon à se maintenir en forme, le corps étant pour lui aussi important que l’esprit puisqu’il est le véhicule d’expression de la pensée et de l’être.
Permettre à Ève de pouvoir profiter pleinement de l’intimité de son logis avec Greg, qui venait la voir de plus en plus souvent à l’époque (compagnon dont je parlerai plus tard), voilà ce qui avait été, douze ans plus tôt, le motif ayant amené Moreau à louer cet appartement secondaire.
Très souvent, à cause des soubresauts du vieil ascenseur, je renversais une partie du café sur le plateau où j’avais préalablement déposé deux tasses. J’ouvrais la porte fermée à clé puis, la plupart du temps, je le trouvais au lit tout joyeux de me voir apparaître. Nous échangions alors un tendre baiser et chaque fois, comme si c’était la première, il me rappelait à quel point il était heureux de se faire réveiller par une si jolie et gentille amie.
__ Tu as bien dormi mon beau nounours? lui demandais-je amoureusement.
__ Oui ma chérie, cette nuit j’ai fait cinq rêves!
Et alors il me les racontait en détail, en m’expliquant pour chacun leur signification. Ensuite, je lui faisais part des miens. Occasionnellement, il me remémorait, afin que je ne l’oublie pas, que l’émotion procurée par le rêve et surtout, l’impression qu’il nous en restait, devaient compter tout autant, sinon plus, que le rêve lui-même. Je lui remettais ensuite une partie du journal et gardais le reste que j’échangerais avec lui plus tard. Lentement, nous dégustions notre café.
Parfois, Moreau me lisait ou me commentait l’actualité politique et artistique. Ou alors, je m’emparais d’un livre de sa bibliothèque et lui demandais de m’en parler. Sa mémoire prodigieuse ne lui faisait jamais défaut : il tenait le volume dans ses mains pour le sentir, en feuilletait quelques pages pour en retrouver l’essence et, graduellement, comme jaillis par enchantement d’une corne d’abondance, les mots sortaient spontanément de sa bouche. Il me racontait l’histoire du roman ou me faisait connaître l’auteur par la qualité de sa plume et les idées exprimées, sa nationalité, son époque et son vécu en tant qu’écrivain ou poète. Même s’il l’avait lu dix ans auparavant, c’était comme s’il venait de le lire. Chaque fois, même si je m’y attendais, le connaissant bien maintenant, je n’en étais pas moins toujours impressionnée et éblouie par l’exactitude de ses souvenirs, par son vocabulaire riche et intarissable décrivant chaque détail avec précision et également par son sens du discernement.
Il me parlait de Casanova, Chateaubriand, Tennessee Williams, James Joyce, de William Faulkner, Shakespeare, Colette, Cocteau, de Virgile et de tous les grands classiques comme s’il les avait connus, côtoyés. Moreau se sentait contemporain de toutes les époques, de toutes les cultures, de toutes les nations.
Ces conversations matinales me remplissaient d’excitation. Je me trouvais privilégiée d’être la compagne d’un génie qui, de plus, m’en faisait découvrir d’autres. Ne possédant pas, toutefois, le dixième de sa mémoire, je ne retenais pas toutes les données et cela me chagrinait. Malgré ma volonté d’apprendre et de retenir ces précieuses connaissances, mes facultés me jouaient des tours. « Les connaissances meublent l’esprit et peuvent contribuer à l’éveiller, me disait-il souvent, mais pas forcément. Ne t’en fais pas, l’essentiel n’est pas là. Les notions intellectuelles, scientifiques et culturelles n’ont rien à voir avec la connaissance proprement dite. De simples ouvriers ou des mères de famille ont la même chance de s’éveiller, de se donner un être en convertissant leur personne à sa part d’éternité. Trop souvent engourdis dans leur raisonnement pour pouvoir rayonner, les gens instruits ratent ce rendez-vous avec l’Absolu. Celui qui a développé son être ne raisonne pas, il rayonne! »
Il m’arrivait aussi de le bombarder de questions relatives à sa philosophie. De moins en moins, il est vrai, car je commençais à la comprendre dans toute sa profondeur. Mais sa pensée était si vaste et touchait tant de domaines différents que j’avais encore besoin d’éclaircissements pour comprendre cet art de vivre érigé en système.
Nos échanges, cependant, n’étaient pas que spirituels. Un amour tendre nous unissait. Je lui demandais si j’étais toujours son petit papillon doré. Il me répondait positivement de façon vibrante. Je savais qu’il ne mentait pas. Jamais, depuis mes trois dernières années à ses côtés, je ne l’avais vu mentir à qui que ce soit. Moreau était un homme de vérité.